Ce sont les médicaments utilisés pour traiter les maladies articulaires mécaniques comme l'arthrose et pour traiter les maladies articulaires inflammatoires : ex polyarthrite rhumatoïde, SPA etc… Ils comprennent plusieurs catégories: LES CLASSES THERAPEUTIQUES
Médicaments pour les maladies articulaires
Les différentes classes thérapeutiques
Traitements symptomatiques :
Antalgiques :
- Palier 1
- Palier 2
- Palier 3
Anti-inflammatoires :
- Anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS)
- Anti-inflammatoires stéroïdiens (corticoïdes)
Traitement de fond :
- Traitements de fond chimiques classiques
- Traitements biologiques ou biothérapies
Les antalgiques
Les 3 principaux types de douleurs
1/ Douleur par excès de nociception (=douleur périphérique)
- Causée par excès de stimulation des récepteurs périphériques de la douleur (nocicepteurs)
- Message à point de départ périphérique: tissu ou organe (ici, l’articulation)
- Localisation précise. Intégrité des voies neurologiques entre périphérie et le SNC
- Ex: arthrose, PR…
2/ Douleur neuropathique
- Due à lésion(s) ou dysfonctionnement(s) du système nerveux,
- Que ce soit au niveau périphérique (nerfs) ou central (cerveau, moelle épinière)
- Caractéristiques :
- Sensations permanentes de brûlure ou de froid
- Décharges électriques ponctuelles
- Picotements, fourmillements ou engourdissements
- Localisation imprécise
3/ Douleur nociplastique (=douleur centralisée)
- Due à dysfonctionnement des systèmes de contrôle de la douleur, sans lésion identifiable
- Caractéristiques:
- Amplification de la douleur par le système nerveux central
- Réponse douloureuse à stimuli normalement non douloureux
- Ex: fibromyalgie, syndrome du côlon irritable, céphalées de tension1
Autre type de douleur
Douleurs psychogènes :
- Rôle essentiel du psychisme
- Somatisation, hypochondrie, stimulation...
- Point de départ = psychisme du malade
- Douleur "sine materia"
La mesure de la douleur
But : Évaluer l’intensité de la douleur à l’aide d’une réglette comportant deux faces : une face patient et une face soignant
Seuil de prescription antalgique :
Si cotation supérieure à 3/10: nécessite une thérapeutique antalgique adaptée.
Correspondance entre niveau d’EVA et intensité de douleur :
De 1 à 3 : douleur faible
De 3 à 5 : douleur modérée
De 5 à 7 : douleur intense
> 7 : douleur extrêmement intense
Classification OMS des antalgiques
A chaque niveau de douleur correspondent des antalgiques adaptés
3 paliers (ou niveaux), en fonction de la puissance antalgique
Palier 1: douleurs légères à modérées
Antalgiques non morphiniques
- Paracétamol, aspirine, AINS
Palier 2: douleurs modérées à intenses
Antalgiques morphiniques faibles (= opioïdes faibles)
- Codéine, associée à paracétamol
- Tramadol
Prescrits aussi en cas d’échec des antalgiques de palier 1
Palier 3: douleurs intenses à très intenses
Antalgiques morphiniques forts (= opioïdes forts)
- Morphine
- Fentanyl
Prescrits aussi en cas d’échec des antalgiques de palier 2
Exemples de médicaments antalgiques par classe
Palier 1: douleurs faibles
Paracétamol: Doliprane, Dafalgan, Efferalgan
Aspirine: Aspégic
Ibuprofène: Advil, Nurofen, Spédifen…
Palier 2: douleurs modérées
Paracétamol codéinés: Codoliprane, Dafalgan Codéine, Klipal
Tramadol: Topalgic, Contramal
Tramadol + Paracétamol: Ixprim
Palier 3: douleurs intenses
Morphine (produit de référence)
Skénan, Acti-skénan
Antalgiques de palier 1 : le paracétamol
Action
Effet antalgique (contre la douleur) action au niveau périphérique
Effet antipyrétique (contre la fièvre) action au niveau du système nerveux central
Indications
Traitement symptomatique de douleurs d'intensité légère à modérée
États fébriles
Utilisé seul ou en association avec d'autres principes actifs comme le tramadol pour traiter des douleurs plus intenses
Posologie : adaptée en fonction de l'intensité de la douleur: 500 mg à 1g par prise (adulte) Intervalle minimum entre les prises : 4 à 6 heures
Dose maximale : 3 g par jour
Ne pas dépasser les doses recommandées pour éviter tout risque de surdosage
Effets indésirables
Réactions allergiques (rares)
Troubles hématologiques (très rares)
Surdosage: peut engendrer une toxicité hépatique grave chez certains patients.
Donc respecter scrupuleusement les doses prescrites
L'aspirine
Actions pharmacologiques :
- Anti-inflammatoire
- Antipyrétique
- Antiagrégant plaquettaire
Indications et posologies :
- Douleurs d'intensité modérés avec ou sans composante inflammatoire
Contre-indications :
- Allergie à l'aspirine
- Maladies hémorragiques et risque d'hémorragie
- Ulcère gastro-duodénal et hémorragies digestives
- Grossesse au 3ème trimestre : toxicité foetale cardio-pulmonaire et rénale + allongement du temps du saignement de la mère et l'enfant
Effets indésirables :
- Troubles gastro-intestinaux : troubles digestifs bénins +++ (épi-gastralgies, nausées, douleur abdominale...), ulcères
Antalgiques de palier 2 : les opioïdes faibles
Codéine - Tramadol
Ce sont tous les deux des dérivés ou de structure proche de la morphine
Action antalgique centrale : (récepteurs morphiniques de l’encéphale)
Action moins importante que la morphine (affinité plus faible pour récepteurs)
Effets indésirables moins importants que la morphine
Souvent associés au paracétamol car permet de potentialiser les effets
Donc utilisation de doses moindres que si opoïdes faibles seuls
Indications thérapeutiques :
- Douleurs modérées à intenses
- Echec des antalgiques de palier 1
Ces antalgiques sont très souvent utilisés en rhumatologie
Correspondent au niveau de douleur rencontré en médecine de ville
Souvent utilisés associés à d’autres molécules afin d’utiliser des doses moins importantes de chacun d’entre eux
Exemple d’association thérapeutique courante :
1 antalgique de palier 2 : paracétamol + codéine + 1 AINS : exemple Voltarène + 1 myo-relaxant : exemple Thiocolchicoside
Précautions d’emploi
L’utilisation de la codéine peut entrainer une somnolence
Donc à prescrire plutôt au coucher si le patient travaille
Ne pas conduire
Ne pas boire d’alcool (potentialisation)
Attention si prise simultanée de médicaments psychotropes: potentialisation
Antalgiques de palier 3 : les opioïdes forts
Ce sont les antalgiques les plus puissants. Antalgiques centraux.
Ils agissent en se liant à des récepteurs encéphaliques spécifiques
Utilisés moins souvent en rhumatologie courante
Car effets indésirables très fréquents
Risque de dépression respiratoire
Prescrits seulement si les antalgiques de palier 1 ou 2 sont insuffisants
Après avoir essayé des associations thérapeutiques avec AINS
En rhumatologie, indication dans les névralgies hyperalgiques :
- Sciatiques hyperalgiques
- Cruralgies hyperalgiques
- Certaines névralgies cervico-brachiales
Cas particulier :
- Métastases osseuses, tumeurs osseuses primitives
Les opioïdes forts : modes d'administration
La morphine se prend :
- Par voie orale (Acti-skénan)
Elle se présente sous différentes formes : comprimés, capsules, gouttes, sirop, suspension.
Dose adaptée en fonction de l’intensité de la douleur et de chaque situation
- Existent en patch (voie transcutanée) : Durogésic
- Si nécessaire, par voie injectable sous-cutanée
- Ou voie intraveineuse, avec beaucoup de précaution, dans les cas extrêmes (risque de dépression respiratoire)
Les opioïdes forts : effets indésirables
Très fréquents, certains sont bénins, d'autre sévères
Bénins :
- Nausées et vomissements
- Somnolence (surtout les 10 premiers jours)
- Constipation : elle est constante. Combattre son apparition par un régime riche en fibres et médicaments laxatifs
Sévères :
- Dépression respiratoire : n’apparait que si doses importantes Nécessite de mettre le patient sous oxygène, voire ventilation assistée ANTIDOTE : Naloxone
Tous les opioïdes forts sont des substances toxicomanogènes si employés au long cours: signifie qu’ils peuvent induire une pharmaco-dépendance
Signification : nécessité d’augmenter les doses pour une même efficacité
Apparition d’un syndrome de sevrage à l’arrêt du traitement
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
L'inflammation associe : "rougeur, chaleur, douleur et oedème"
Dans quelques situations et maladies, la réponse inflammatoire peut être exagérée et prolongée
Donc indications très larges en rhumatologie
AINS : définition et indications
Les AINS sont des médicaments symptomatologiques capables de s'opposer au processus inflammatoire, quelle qu'en soit la cause : mécanique, chimique, infectieuse et immunologique.
Les AINS appartiennent à plusieurs familles chimiques et ils se caractérisent par l'absence d'une structure chimique stéroïdienne.
Indications thérapeutiques
Etats inflammatoires aigus, ex : inflammation post traumatique
Etats inflammatoires chroniques, ex : maladies rhumatismales
AINS : effets positifs
Effet anti-inflammatoire : diminution
- De l'œdème
- De l'épanchement
- De la vasodilatation responsable de la rougeur
- Et de la chaleur locale
Effet antalgique :
- Diminution de la douleur
Ils ont également un effet antipyrétique :
- Lutte contre la fièvre
(Celle-ci est le plus souvent absente dans les maladies rhumatismales non infectieuses)
AINS : effets indésirables
Bien les connaître car permettent de comprendre les contre-indications
- Irritent la muqueuse gastrique
Peuvent entrainer brulures d’estomac, gastrite, ulcère gastro-duodénal
Hémorragie digestive
Contre-indiqués si antécédente de gastrite et d’ulcère gastro-duodénal
Leur prescription nécessite l’association à un anti-ulcéreux (IPP)
- Allongent le temps de saignement (anti-agrégant)
Contre-indiqués chez patients sous anti-coagulants
- Diminuent le flux sanguin rénal
Contre-indiqués en cas d’insuffisance rénale
- Diminuent la motricité utérine
Risquent de prolongation de la gestation
De + toxicité fœtale
Contre-indiqués pendant la grossesse
Attention: les AINS diminuent l’efficacité des dispositifs intra-utérins
AINS : exemples par famille chimique
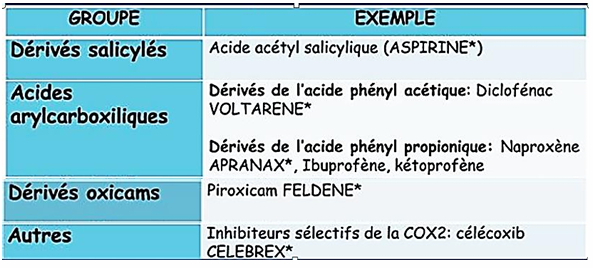
Les anti-inflammatoires stéroïdiens = A.I.S. = corticoïdes
Les surrénales sécrètent des corticoïdes naturels
Activité hormonale importante
- Gluco-corticoïdes : cortisol
- Minéralo-corticoïdes : aldostérone
- Précurseurs des hormones sexuelles
Action anti-inflammatoire faible
Les corticoïdes médicamenteux sont des molécules de synthèse dérivées des corticoïdes naturels, choisies pour avoir des effets hormonaux plus faibles et des effets anti-inflammatoires plus forts
Ils ont également un effet immuno-suppresseur
- Avantage pour traiter certaines maladies avec dérèglement immunitaire
- Inconvénient chez sujet fragiles : augmente risque infectieux
Médicaments corticoïdes
Ce sont des dérivés chimiques des corticoïdes physiologiques
On les appelle GLUCO-CORTICOÏDES DE SYNTHESE
Molécules « copiées » sur la cortisone naturelle, puis modifiées en laboratoire
PREDNISONE
PREDNISOLONE
BETAMETHAZONE
DEXAMETHAZONE
Voies d’administration :
- Voie orale (comprimés)
- Voie intra-veineuse
- Voie locale: suspension de corticoïdes : infiltrations locales
Corticoïdes par voie générale et locale
Spécialités voie orale :
- Prednisone : CORTANCYL
- Prednisolone : SULUPRED / HYDROCORTANCYL
Par voie locale (infiltration) :
- Prednisolone : HYDROCORTANCYL
- Bétaméthasone : CELESTENE CHRONODOSE / DIPROSTENE
Corticoïdes par voie générale : indications en rhumatologie
Indiqués dans les rhumatismes inflammatoires chroniques
Indiqués aussi dans les poussées inflammatoires des maladies dégénératives en cas d'échec des AINS
- Sciatiques
- Cruralgies
- Névralgies cervico-brachiales
- Poussées d'arthrose sévère
Corticoïdes par voie générale : principaux effets indésirables
Présents si traitement prolongé par voie générale
- Rétention hydro-sodée : risque d’hypertension artérielle
- Fuite urinaire de calcium : risque d’ostéoporose, nécrose de la tête fémorale
- Diminution de la tolérance au glucose : risque de diabète
- Augmentation du catabolisme protéique : risque d’amyotrophie, risque de rupture tendineuse
- Troubles neuro-psychiques : effet psycho-stimulant : insomnie Donc médicament à prendre le matin
- A NOTER : muqueuses digestives : effet moins toxique que les AINS
Corticoïdes par voie générale : contre-indications
- Etat infectieux non contrôlé
- Viroses évolutives : herpes, zona oculaires, hépatite A ou B
- Ulcères évolutifs
- Goutte
Précautions d'emploi :
- Hypertension artérielle
- Diabète
- Ostéoporose
- Glaucome
Corticoïdes par voie locale intra-articulaire
Définition :
- Ils font partie des corticoïdes de synthèse
- L'administration locale de corticoïdes : permet d'obtenir un effet anti-inflammatoire local en minimisant les effets secondaires généraux de la corticothérapie
Indications :
- Infiltrations articulaires : arthrose ou rhumatisme inflammatoire
- Infiltrations péri-articulaires : tendinites
- Infiltrations épidurales : sciatiques
Corticoïdes par voies locale intra-articulaire
Molécules utilisées
- DIPROSTENE : infiltrations des membres (suspension de prednisolone)
- HYDROCORTANCYL : infiltrations du rachis (solution de prednisolone)
Précautions emploi :
Risque d'arthrite infectieuse : Asepsie chirurgicale
- Lavage des mains : médecins
- Matériel à usage unique
- Désinfection de la zone de ponction
Effets indésirables
Très limités et rarement observés
Mais ... effet cumulatif au cours de la vie
Parfois risque de rupture tendineuse si nombreuses infiltrations
Inhibent la duplication cellulaire des cellules cartilagineuses...
Les traitements de fond en rhumatologie
Généralités
Les traitements de fond traitent la cause de l’inflammation articulaire.
Objectif : arrêter l’évolution de la maladie.
Pour les rhumatismes inflammatoires chroniques, il s’agit de médicaments qui vont lutter contre le dysfonctionnement du système immunitaire.
Il existe aussi des traitements de fond pour d’autres maladies rhumatismales comme l’ostéoporose ou la goutte (absence de dérèglement immunitaire)
Certaines pathologies dégénératives comme l’arthrose, ou certaines arthropathies microcristallines n’ont pas de traitement de fond.
L’efficacité des traitements de fond est souvent tardive, et ne pourra être évaluée en général qu’après 3 mois d’utilisation.
Tous les traitements de fond présentent des effets indésirables qu’il faut connaître. Leur utilisation nécessite une surveillance clinique et biologique.
Traitements de fond dans les rhumatismes inflammatoires
Traitements de fond chimiques conventionnels
- Méthotrexate (Novatrex)
- Hydroxychloroquine (Plaquénil)
- Cyclophosphamide (Endoxan)
- Azathioprine (Imurel)
Traitements de fond biologiques = biothérapies (micro-immunothérapie)
Utilisés dans certains rhumatismes inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrites, lupus) en cas d’inefficacité ou d’efficacité insuffisante des traitements de fonds chimiques classiques (pas utilisés en première intention).
Efficacité remarquable sur l’inflammation articulaire.
Peuvent conduire à des rémissions spectaculaires, mais ne guérissent pas les rhumatismes inflammatoires.
Effet suspensif : la maladie réapparaît habituellement à l’arrêt du traitement.
Traitements de fond chimiques conventionnels
- Méthotrexate - MTX - (Novatrex)
Traitement de fond chimique le plus utilisé dans les rhumatismes inflammatoires depuis plus de 30 ans. Effet cytostatique (inhibe la division cellulaire) et un effet immunosuppresseur
Initialement développé comme anticancéreux.
Utilisé dans les rhumatismes inflammatoires à petites doses hebdomadaires
Efficacité retardée: au bout de 3 mois.
Peut être associé à d’autres traitements de fond, en particulier, aux biothérapies, ou à d’autres traitements de fond chimiques.
Surveillance par prises de sang mensuelles
- Toxicité sanguine (pancytopénie)
- Hépatique
- Rénale
- Hydroxychloroquine (Plaquénil)
Traitement de fond chimique qui se prend à raison de 1 ou 2 comprimés/j
Efficacité retardée: apparaît dans les 6 à 12 semaines.
Surveillance ophtalmologique nécessaire (rétinopathie, rare)
- Cyclophosphamide (Endoxan) et Azathioprine (Imurel)
Font aussi partie des immunosuppresseurs (diminuent l’activité du système immunitaire)
Utilisés quand les arthropathies sont associées à des atteintes d’organes sévères des maladies auto-immunes +++
Surveillance biologique régulière nécessaire: NFS, bilan hépatique et rénal
Les biothérapies : rhumatologie hospitalière
Ont révolutionné le traitement des rhumatismes inflammatoires chroniques +++ comme la polyarthrite rhumatoïde et les spondylarthrites depuis les années 2000
Principe d'action
Médicaments fabriqués à partir d'organismes vivants ou d'éléments prélevés sur des organismes vivants
Agissent de manière ciblée sur les mécanismes de l'inflammation responsables des symptômes des maladies rhumatismales
Principales classes de biothérapies
- Anti-TNF alpha = les premières biothérapies apparues
Bloquent l'action du TNF alpha, une protéine pro-inflammatoire
Ex: Etanercept (ENBREL®), Adalimumab (HUMIRA®)
- Autres biothérapies : agissent sur le système immunitaire à différents niveaux
Ex : Abatacept (ORENCIA®) : inhibe l'activation des lymphocytes T
Rituximab (MABTHERA®) : détruit certains lymphocytes B3
Tocilizumab (ROACTEMRA®) : bloque le récepteur de l'interleukine 6
Inhibiteurs de l'IL-12, l'IL-17A et de l'IL-23 (pour le rhumatisme psoriasique)
Biothérapies : indications et modes d'administration
Indications
Les biothérapies sont prescrites lorsque la maladie reste active malgré un traitement de fond classique bien conduit pendant 3 à 6 mois
Médicaments dits DE DEUXIEME INTENTION
Indiquées dans :
- La polyarthrite rhumatoïde
- Les spondylarthrites
- Le rhumatisme psoriasique
Modes d’administration
Ces traitements sont administrés :
- Par voie injectable sous-cutanée
- Perfusion intraveineuse
- Par voie orale pour les inhibiteurs des JAK (= une nouvelle classe)
Les biothérapies : points importants
Les biothérapies ont considérablement amélioré la prise en charge des rhumatismes inflammatoires, en offrant de nouvelles options thérapeutiques efficaces pour contrôler l'inflammation et ralentir l'évolution de ces maladies chroniques
Nécessitent une prescription hospitalière initiale par un rhumatologue
Médicaments coûteux dont les indications doivent être respectées
Bilan pré-thérapeutique nécessaire pour écarter les contre-indications, notamment infectieuses
Choix de la biothérapie se fait en fonction du profil du patient et de sa maladie
Surveillance médicale régulière obligatoire.
Le risque le plus important concerne les infections : surveiller apparition d’une fièvre
En cas d’apparition de la moindre fièvre, le traitement doit être interrompu
Médicaments pour les maladies osseuses
Traitement classique de l'ostéoporose
Les 2 maladies osseuse déminéralisantes : ostéoporose et l’ostéomalacie
Traitement médicamenteux classique : association de :
- Calcium et de Vitamine D
- En principe administrés en cas de carence. La carence en calcium dépend des apports alimentaires. La carence en vitamine D dépend essentiellement de l’exposition au soleil.
Comprimés ou sachets de calcium : Calcium, Orocal*, Fixical*, Calcidose*
Vitamine D :
- Soit forte dose espacée: 100 000 U.I sous forme d’ampoules buvables 100 000 UI 1 fois tous les 3 mois : UVEDOSE*, ZYMAD*, ou 50 000 U.I. tous les 2 mois : UVEDOSE* , ZYMAD*
- Soit petite dose quotidienne: 600 à 800 U.I. par jour: vitamine D3 CHOLECALCIFEROL : 3 à 4 gouttes par jour
Il existe des comprimés associant calcium et vitamine D: ex: Orocal Vit D3*, Calpéros D3*
Traitement de l'ostéoporose révère
Traitement spécifiques proposés si les résultats de la densitométrie osseuse montrent une ostéoporose importante voire sévère (fractures associées)
Les biphosphonates
Agissent en bloquant les cellules qui détruisent l'os (= ostéoclastes) luttant ainsi contre la déminéralisation.
Diminuent le risque de fractures vertébrales et de la hanche dues à l'ostéoporose.
- Alendronate (FOSAMAX*)
- Risedronate (ACTONEL*)
- Souvent associés à une supplémentation en vitamine D et en calcium pour optimiser leur efficacité.
- Action de longue durée. Selon la molécule, prise de bisphosphonate journalière, hebdomadaire ou mensuelle.
Médicaments pour les arthropathies micro-cristallines
Traitement de la crise de goutte
Les arthropathies microcristallines se caractérisent par des dépôts de microcristaux
- En intra-articulaire
- Ou dans les tissus péri-articulaires
- Pour la goutte, il s’agit de dépôts d’acide urique
Le traitement médicamenteux principal de la crise de goutte est :
- La colchicine (COLCHICINE*, ou COLCHIMAX*)
Extraite d’une plante, la colchique.
Agit en diminuant l’inflammation et en freinant aussi la production d’acide lactique, ce qui diminue l’acidité dans l’articulation (l’acidité favorise la précipitation des cristaux d’acide urique, point de départ de la crise de goutte)
Prise par voie orale (comprimés à 1 mg)
- On peut également utiliser les anti-inflammatoires non-stéroïdiens
Traitements au long cours
Les crises de goutte sont liées à la présence d’une quantité d’acide urique excessive dans le sang, c’est l’hyperuricémie
Traitement de l’hyperuricémie : les hypo-uricémiants
Objectif: faire revenir l’uricémie à la normale (si possible < 60 mg/litre), on fait alors disparaître les crises de goutte.
Molécule qui diminue la production d’acide urique :
- Le classique allopurinol = ZYLORIC*
Par voie orale sous forme de comprimés

